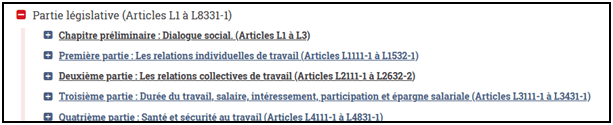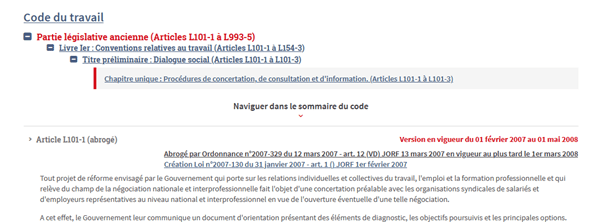(Je reproduis, dans ce dernier billet du mini-dossier consacré à l’art de la réforme, des extraits de la tribune d’Olivier Mériaux, ancien directeur-adjoint de l’Anact, parue dans le journal Le Monde du 24 janvier dernier sous le titre suivant : Réforme des retraites : Reculer l’âge légal sans avoir obtenu de résultats tangibles en matière d’emploi des seniors est hypocrite et dangereux.
Je clos ce dossier en m’interrogeant sur la méthode qu’il aurait fallu déployer ces derniers mois pour que cette réforme des retraites, nécessaire dans son esprit, soit une réforme acceptée car négociée…).
« Il y a trois ans, alors que le gouvernement d’Edouard Philippe préparait une réforme des retraites déjà contestée, mais qui avait au moins l’ambition de proposer une refonte systémique, j’ai accepté de contribuer à l’effort de réflexion en participant à la rédaction d’un rapport sur « l’emploi des seniors », remis à la ministre du travail de l’époque en janvier 2020. La survenue de la pandémie de Covid-19 a scellé le sort du projet gouvernemental, comme celui de notre rapport.
C’est sur la base de la connaissance acquise lors de cet exercice que je peux aujourd’hui affirmer clairement que rien dans le projet actuel n’est en mesure d’« équilibrer » le caractère fondamentalement inéquitable du report de l’âge légal et ses conséquences désastreuses en termes de cohésion sociale.
Aucun « index seniors », aucun « fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle » (même en supposant que l’on sache comment dépenser efficacement le milliard d’euros que l’on dit vouloir y consacrer), aucune même des propositions sur les transitions emploi-retraite que j’avais pu soutenir dans le rapport de 2020 et que l’on retrouve dans l’actuel projet de loi ne pourra contrebalancer les impacts d’un recul de la borne d’âge pour une large partie du corps social, déjà fragilisée.
Cela pour une raison simple, que le président de la République avait parfaitement su formuler dans sa conférence de presse post-grand débat national d’avril 2019 : n’ayant aucune conséquence pour les salariés les plus qualifiés, sortis tardivement de leurs études, le recul de l’âge légal fait peser tout l’effort et tous les risques sur la population des « travailleurs pauvres », ceux et surtout celles qui occupent les emplois les plus pénibles et qui ont souvent eu des parcours professionnels en dents de scie.
Ce qui pose fondamentalement problème, c’est que si les impacts individuels d’une telle décision sont immédiats et certains, les évolutions des pratiques de gestion des entreprises qui pourraient éventuellement les atténuer restent hypothétiques. Et dans tous les cas seront longues à se concrétiser.
Car, faut-il vraiment le rappeler, les salariés en fin de carrière ne décident pas tout seuls de leur sort. Et la gestion « optimisée » de la pyramide des âges par les entreprises est par nature résistante au changement, quand bien même une certaine coercition serait appliquée pour qu’elles gardent plus longtemps leurs salariés (ce qui n’est absolument pas l’optique du projet gouvernemental).
Dans ces conditions, reculer l’âge légal sans avoir obtenu au préalable des résultats tangibles en matière d’emploi des seniors est non seulement « hypocrite », comme le disait Emmanuel Macron en avril 2019, mais surtout dangereux pour ce qui reste de cohésion sociale dans le pays. Et ce d’autant plus après avoir réduit la durée maximale d’indemnisation du chômage, y compris pour les plus âgés.
Brandir l’argument selon lequel le plein-emploi changerait la donne aujourd’hui ajoute la tromperie à l’hypocrisie : compte tenu de l’ampleur du phénomène de « halo de l’inactivité » pour ces classes d’âge, la mesure du taux de chômage ne rend absolument pas compte de la réalité du fonctionnement du marché du travail.
A ce stade, la discussion sur la pertinence et l’ampleur des « mesures d’accompagnement » du report à 64 ans de l’âge légal reste de toute façon hautement spéculative. Compte tenu du véhicule législatif choisi par le gouvernement – un projet de loi de financement de la Sécurité sociale rectificatif –, le risque est non négligeable que le Conseil constitutionnel censure les mesures qui ne seraient pas en rapport direct avec le sujet de l’équilibre des comptes. Difficile d’imaginer que ce risque n’ait pas été identifié et mesuré…
Raison supplémentaire pour arrêter le jeu de dupes, remiser les mesures d’âge et prendre le sujet à l’endroit : commencer par coconstruire les solutions équitables pour que l’allongement de la vie professionnelle ne soit plus synonyme de damnation au travail pour les uns ou de relégation sociale pour les autres.
(Olivier Mériaux, Le Monde, 24 janvier 2023)
***
« Raison supplémentaire pour arrêter le jeu de dupes, remiser les mesures d’âge et prendre le sujet à l’endroit : commencer par co-construire les solutions équitables pour que l’allongement de la vie professionnelle ne soit plus synonyme de damnation au travail pour les uns ou de relégation sociale pour les autres. » Tout est dit, et bien dit, par Olivier Mériaux dans les lignes conclusives de sa tribune. La seule question qui vaille, dès lors, est une question de méthode : comment co-construire de telles solutions équitables ?
Trois défis sont à relever : celui du diagnostic partagé, celui de l’appropriation des scénarios aux situations personnelles complexes, et celui de l’équité de ces scénarios s’ils sont adaptés aux personnes. Ce sont là des processus délibératifs de haute intensité ; ils supposent des procédures pour les encadrer et des animateurs pour les piloter. Il n’est pas interdit d’en discuter collectivement, dès aujourd’hui. Voici quelques premières réflexions.
Une tribune de plusieurs universitaires (dont François Dubert, Olivier Mongin, Bruno Pallier et Michel Wieviorka), intitulée « Une réforme des retraites est nécessaire mais celle proposée est lourde de nombreuses injustices » (Le Monde du 7 février ; lire ici) pointe le déficit démocratique dans l’élaboration de la réforme. Ils écrivent ceci : « L’élaboration du projet gouvernemental n’a pas été suffisamment démocratique. Une réflexion systématique aurait dû être proposée en amont, en posant clairement l’objectif de cette réforme et en ouvrant le débat sur les différentes options possibles de financement des retraites, sans faire du paramètre de l’âge un critère incontournable. Elle aurait dû faire apparaître plus tôt les carences et les lacunes du projet gouvernemental. »
Une précédente tribune, de Benjamin Morel, publiée dans Le Monde le 17 janvier et intitulée « Faire passer la réforme des retraites par la voie d’un projet de loi de finances rectificatif de la Sécurité Sociale est plus qu’un détail technique » (lire ici) indiquait ceci : « Qu’elle soit absurde ou nécessaire, cette réforme des retraites peut être un grand moment de démocratie, à condition d’en débattre. »
Si l’on transforme les nombreuses critiques faites dans les diverses tribunes publiées ces derniers jours en modalités concrètes de délibération collective et d’aide à la prise de décision, cela donne à peu près cette première liste :
- Poser les termes du débat le plus en amont possible ;
- Organiser et systématiser le processus de réflexion ;
- Indiquer clairement l’objectif de la réforme envisagée ;
- Ouvrir le débat sur les différentes options possibles, après en avoir dressé la liste et présenté, preuves à l’appui, leurs avantages et inconvénients ;
- Ne pas polariser sur un seul des paramètres en jeu ;
- Identifier rapidement les carences et lacunes du projet en son état ;
- Faire débattre les acteurs concernés, en profondeur, dans la durée ;
- Ne pas dévaloriser le processus de concertation en excluant d’emblée certains paramètres du champ de cette concertation ;
- Utiliser le haut-commissariat du Plan comme espace délibératif ;
- Prendre le temps de débattre, sans occulter aucune composante du projet ;
- Fournir des données quantitatives et qualitatives relatives aux autres systèmes nationaux ;
- Pour les différentes options en rivalité, publier les arguments, pro et contra, des différents experts à leur sujet ;
- Veiller à ne pas dénaturer, caricaturer et déconsidérer le propos des opposants au projet ;
- Donner au débat parlementaire toute sa place, le temps nécessaire, sans recourir à des artifices constitutionnels, type les articles 47-1 ou 49-3 ;
Je reproduis ci-dessous quelques extraits du chapitre 8 de mon ouvrage, Décider à plusieurs, paru aux PUF en 2017, notamment la section intitulée Co-concevoir des solutions avec ceux qui sont concernés ou qui seront affectés :
« Le terme outre-manche pour désigner cette posture et les procédures qui l’accompagnent est : l’Open Policy-Making. Il s’agit d’enrichir la conception et la mise en œuvre des politiques publiques en impliquant les usagers, les fonctionnaires, les experts et toute autre partie prenante, le tout en utilisant les technologies numériques.
S’inspirant de la méthode dite du design thinking – soit un processus de co-création, où l’identification des problèmes et des scénarios alternatifs s’opèrent de façon itérative –, le gouvernement britannique a mandaté en 2012 une équipe pour concevoir et implanter cette Open policy making au sein des ministères. Trois étapes principales composent cette production « ouverte » des politiques publiques anglaises : consulter (les usagers) ; analyser (les données ainsi recueillies, via des experts, et des allers-retours auprès des usagers) ; enfin, implanter ces politiques, selon la méthodologie dite « agile » (associant usagers et concepteurs). L’objectif est le suivant : « aider les fonctionnaires à créer et mettre en œuvre des politiques répondant aux exigences d’un monde en rapide évolution et de plus en plus numérique. »
La lecture attentive de l’« Open Policy Making Toolkit », soit la boîte à outils de cette production « ouverte » des politiques publiques, méticuleusement décrite sur le site du gouvernement britannique, à l’intention des policy-makers, les concepteurs de ces politiques publiques, est recommandée à tout lecteur du présent ouvrage. Contentons-nous de citer ici, sans les commenter, des extraits de quelques unes des nombreuses rubriques de ce toolkit.
À la question « Comment devenir un concepteur de politiques publiques ouvertes ? », le document répond ainsi :
« Être ouvert aux nouvelles idées et aux nouvelles façons de travailler. L’écoute de nouvelles idées et l’engagement de personnes vous donneront de nouvelles idées et vous aideront à voir les problèmes d’un point de vue différent. La conception et le travail agile sont des exemples de nouvelles approches qui peuvent aider à voir un problème du point de vue de l’utilisateur.
Soyez humble. Il est essentiel de rassembler des preuves, des informations et un large éventail de points de vue. Il est important d’être humble sur ce que vous savez, et ce que vous ne connaissez pas. La politique ouverte consiste à reconnaître que vous n’êtes pas le seul expert et que vous n’avez pas le monopole sur les bonnes idées et l’élaboration de politiques. Là où de bonnes idées existent, c’est votre travail de les trouver.
Soyez prêt à reconnaître que quelque chose ne fonctionne pas. Soyez ouvert aux nouvelles suggestions, aux nouvelles données et aux nouvelles preuves. Cela vous aidera à comprendre les différents points de vue et apporter des améliorations itératives. »
Suivent diverses recommandations. Parmi elles :
« Comprendre les besoins réels des utilisateurs. La compréhension des besoins des utilisateurs vous aidera à élaborer une politique qui fonctionne pour les personnes qu’elle concerne. Commencez par comprendre quelle expérience ont les usagers de cette politique.
Impliquer le public. S’engager avec le public vous aidera à comprendre et à mesurer son humeur. Les gens qui ont le plus de connaissances sur la façon dont les services et les politiques fonctionnent sont ceux qui les connaissent de première main. Leurs expériences peuvent vous aider à comprendre les besoins des citoyens et à penser de façon plus éclairée.
Testez et utilisez des preuves pour améliorer au fur et à mesure votre politique. Testez et itérez des solutions pour vous assurer qu’elles fonctionnent pour les usagers dans le monde réel. Cela vous aidera à passer de l’idée au produit livrable, et qui fonctionne.
Utiliser les données pour apprendre, mettre à l’épreuve et réussir. Utilisez les données pour générer de nouvelles idées et apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Cela vous dira qui est votre public et qui sont les usagers, et vous aidera à comprendre le problème de leur point de vue. »
Une autre rubrique intéressera le lecteur, celle à propos du dialogue délibératif. Le texte gouvernemental indique : « Le dialogue délibératif utilise un environnement impartial et facilité pour rassembler le public, les experts et les décideurs politiques afin de discuter des questions de politique et trouver des solutions possibles.
Un dialogue délibératif n’est pas une réunion publique ni une discussion. Il s’agit d’une conversation soigneusement structurée qui aide les gens à non seulement parler ensemble, mais penser ensemble. Les facilitateurs recherchent un terrain d’entente et découvrent des solutions possibles en travaillant avec les usagers dans un espace ouvert et sûr. Il utilise une variété de techniques créatives pour aider les gens à développer et à expliquer leurs points de vue sur une question. »
Quand utiliser un dialogue délibératif ? Le site du gouvernement anglais répond ainsi : « Vous devriez commencer un dialogue dès les premières étapes de la construction de la politique afin que les opinions des usagers et du public puissent être utilisées pendant la conception et la mise en œuvre de la politique.
Chaque processus de dialogue est différent et peut utiliser toute une variété de techniques délibératives différentes, selon les objectifs, les personnes concernées et les ressources disponibles.
Un dialogue délibératif est un processus complexe qui a besoin de temps et de réflexion.
Vous devez utiliser des experts pour créer et entretenir un dialogue délibératif. Il est recommandé d’utiliser un animateur pour que le dialogue soit neutre et impartial. Cela aidera le public à partager ses sentiments et ses opinions. »
Parmi les différentes méthodes de collecte des données et de mise à l’épreuve des politiques, le document recense : l’approche ethnographique ; l’exploitation des messages sur les réseaux sociaux, des données publiques (open data), la pratique des « tests-guérilla » (effectués n’importe où, dans un café, une gare ou une bibliothèque), les idées produites lors d’« idea jams » (des réunions improvisées, qui rassemblent experts, concepteurs et usagers ; le recueil d’opinions via des entretiens avec des usagers, des cartes imagées (telles les hope and fear cards), pour les faire réagir, via de simples esquisses (à la place d’idées déjà élaborées, que certains usagers ont de la peine à produire), ou via des knowledge safaris (« chasses aux connaissances »), des récits d’expérience (journey mapping), ou des challenge panels (débats controversés ) ; enfin, le prototypage (pour tester un dispositif).
Pléthore d’outils, donc, dont le décideur collectif peut s’inspirer pour sa propre boîte à outils…
Comment rendre plus démocratiques nos procédures collectives de décision, sans dégrader leur qualité ?
En mettant au centre de ces mécanismes un ingrédient majeur de la démocratie : l’égalité. Ce qui signifie : rendre égale la possibilité pour tout citoyen, usager, membre d’une organisation ou d’un groupement, de participer à la construction des décisions (présentes ou futures) le concernant. Plusieurs outils ont été expérimentés et ont démontré leur efficacité, comme les forums ouverts (et ses formes approchées, tel le forum communautaire) ou les sondages délibératifs.
L’idée d’un forum ouvert organisé par le CNRS et le Muséum d’histoire naturelle, indique l’une de ses responsables, est « de demander au grand public de définir lui-même le thème d’un nouvel observatoire dédié au changement climatique et à la biodiversité. Le but est de brasser les propositions de personnes venues de tous les horizons pour faire émerger des thématiques inédites. Le forum a été pensé pour trouver une réponse à une question complexe en un minimum de temps en sollicitant un maximum de personnes. »
Caractéristiques de ces forums : personne ne sait qui sont les autres participants – ce qui est réputé faciliter les échanges ; la parole de chacun pèse le même poids ; des thèmes sont affichés sur un mur, les participants débattent des thèmes à approfondir ; réunis en petits groupes, ils restituent ensuite à tous leurs débats ; des experts, présents tout au long du processus, apportent leurs éclairages ; l’outil numérique aide à coordonner les débats et les idées ; des projets (ou des priorités) sont adoptés (définies) par vote (le plus souvent électronique).
Diverses variantes de ce principe sont possibles : en jouant sur la taille des groupes et la circulation des idées (tels les world cafés – débats en groupe de 4 à 5 personnes ; les participants changent souvent de table de discussion, de sorte qu’il y a « pollinisation des idées » et qu’au fil des changements de table, les participants retravaillent les idées déjà émises, ou les confrontent aux leurs, etc.), en mobilisant les dispositifs numériques, via des plateformes web, ou encore en orientant les débats vers des priorités immédiates (tels les budgets participatifs, pour définir les dépenses et recettes d’une mairie de quartier) ou des solutions de plus long terme (tels les ateliers de scénarios, avec une confrontation entre experts et élus / habitants / collectivités).
Les sondages délibératifs ont été imaginés par James Fishkin (voir son ouvrage When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation, Oxford University Press, 2009). Il décrit ainsi la méthode : « Sélectionnez sur une base nationale un échantillon aléatoire de citoyens en âge de voter et interrogez-les sur telle(s) ou telle(s) question(s) politique(s). Distribuez-leur une documentation équilibrée et accessible afin de les informer et de les inciter à réfléchir sérieusement à la question. Réunissez-les tous au même endroit pendant plusieurs jours et faites-les discuter entre eux en petits groupes composés de façon aléatoire et conduits par des modérateurs. Que les questions suscitées par ces discussions soient ensuite soumises à un panel scrupuleusement équilibré d’experts et de dirigeants politiques. Au terme de ce processus, interrogez de nouveau les participants en utilisant le même questionnaire qu’au début ».
Extrait d’un entretien (5 mars 2012) avec Bruce Ackerman pour La République des idées : « Nous utilisons la technique du sondage délibératif ; nous l’avons fait 75 fois sur les quinze ou vingt dernières années, de la Bulgarie aux États-Unis en passant par l’Australie, le Royaume-Uni, l’UE et la Chine. Nous ne l’avons pas encore fait en France, mais ça nous plairait beaucoup. En 1994 et 1995 au Royaume-Uni, nous avons par exemple organisé deux sondages sur la position du Royaume-Uni sur l’Europe. Nous envoyons un sondeur professionnel chez environ 300-400 personnes choisies au hasard mais réparties en termes de région, de sexe et de revenu, pour leur dire : « Félicitations ! Nous vous invitons à venir à Manchester participer à un jour et demi de délibération. » (…) Nous leur envoyons ensuite un livret informatif (c’est maintenant un film), où chaque camp a l’occasion de fournir une quantité égale d’informations sur le sujet. Ensuite les participants viennent à Manchester. Fishkin s’occupe admirablement de la promotion ; il fait venir la BBC et les journaux pour couvrir l’événement. On a Tony Blair d’un côté, et quelqu’un d’autre de l’autre, mais toujours des grands noms. Ils ont chacun une heure, une heure et demie pour leur plaidoyer. Après les sessions plénières, les gens se divisent en petits groupes de quinze et font la liste des questions que les orateurs n’ont pas abordées de manière satisfaisante. On enchaîne alors sur une deuxième session plénière, où un arbitre lit les questions de chaque groupe pour que les orateurs y répondent. Après la pause-déjeuner, les participants ont une nouvelle discussion, puis nous leur faisons remplir le même questionnaire que celui qu’ils avaient rempli chez eux, et nous comparons leurs réponses. L’analyse scientifique des deux versions du questionnaire permet d’établir que la délibération sert bien à quelque chose. » (…)
L’idée est, comme le note Loïc Blondiaux, de « contrôler ce formatage inéluctable de l’opinion en donnant aux personnes interrogées l’information la plus complète et la plus équilibrée possible ». Le principe peut donc être étendu à nos décisions collectives : intégrer au processus décisionnel lui-même un moment spécifique – nommons-le : le moment informationnel-délibératif –, de sorte que la collecte, le traitement, la vérification et la compréhension des informations soient des séquences-clé de la procédure. (…)
Dans la conclusion de son ouvrage, Le nouvel esprit de la démocratie, Loïc Blondiaux formule six recommandations pratiques : un, prendre au sérieux les formes matérielles de la délibération, à savoir les procédures, les dispositifs techniques, les équipements, les lieux, etc. ; deux, encourager l’émergence de pouvoirs neutres, garants du bon déroulement des discussions publiques et des opérations participatives ; trois, promouvoir une constitution démocratique mixte, de façon à favoriser la confrontation des élus et des citoyens ; quatre, jouer sur la complémentarité des dispositifs participatifs,et ne pas hésiter à innover ou à les adapter selon la situation ; cinq, repenser la question de la décision, au sens où la démocratie participative, dit-il, n’a pas vocation à produire directement la décision mais à l’enrichir et à l’éclairer de points de vue jusqu’alors négligés ; et six, réaffirmer sans cesse l’idéal d’inclusion. »