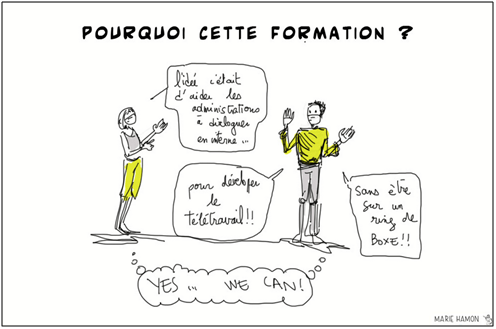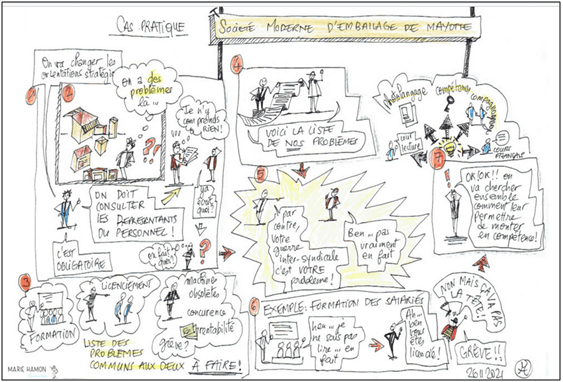(Pour nourrir la réflexion sur l’accord collectif, je reproduis ci-dessous l’intervention d’ouverture de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, lors du colloque organisé le vendredi 13 novembre 2015 par le Conseil d’État dans le cadre des « Entretiens en droit social », alors consacré à L’accord : mode de régulation du social.
Jean-Marc Sauvé souligne ici un paradoxe : le maintien d’une forte activité étatique en matière de dialogue social, et le faible développement de la négociation collective, alors même que cet État fait son possible pour l’assurer. Et propose une explication : « une insuffisante appropriation du domaine reconnu par la loi à la négociation collective et une faible maniabilité de ses outils ». L’accord collectif, en France, souligne-t-il, « semble trop souvent le fruit d’une contrainte extérieure ou inadaptée ».)
***
« Mesdames et Messieurs, mes chers collègues,
En matière de régulation des rapports sociaux, comme en d’autres domaines, l’exception française prend la forme d’un paradoxe : alors que notre pays ouvre plus que ses voisins un large champ à la négociation collective, qui est devenue une source autonome et importante de notre droit social, le poids de la loi apparaît écrasant et comme une source d’inhibition.
Les dispositions du code du travail sont certes trop nombreuses et trop complexes, mais dans le même temps, ont été signés en 2014 par les partenaires sociaux 951 accords de branche et 36 500 accords d’entreprises.
Pour comprendre ce paradoxe, il faut tout à la fois déconstruire l’image d’Épinal d’un État à propension dirigiste, étouffant par ses lois et règlements les voix du dialogue social, et évaluer l’inapparente vitalité de la négociation collective, qui est forte mais aussi trop peu fluide et innovante.
La clé de compréhension réside sans doute dans les imperfections de notre cadre juridique et, notamment, dans celles de notre droit du travail, trop massif et trop vertical, qui, comme le soulignent Robert Badinter et Antoine Lyon-Caen, peut « joue[r] contre les travailleurs qu’il est censé protéger »
Mais ce paradoxe s’explique aussi par une insuffisante appropriation du domaine reconnu par la loi à la négociation collective et dans une faible maniabilité de ses outils : l’accord collectif en France semble trop souvent le fruit d’une contrainte extérieure ou inadaptée. Sur chacun de ces points, des diagnostics ont été posés, des propositions formulées et des projets de réforme engagés.
Dans le prolongement du rapport de mon collègue Jean-Denis Combrexelle, le Gouvernement a présenté, le 4 novembre dernier, les lignes directrices d’un chantier de refonte du droit du travail. Le présent colloque, organisé par le Conseil d’Etat dans le cadre de ses « Entretiens en droit social »s’inscrit par conséquent dans une actualité dense, dont il sera naturellement question.
Mais ce colloque sera aussi l’occasion de s’intéresser aux accords collectifs dans le domaine de la santé. C’est ainsi la logique contractuelle elle-même, au-delà des seules conventions collectives, qui sera au cœur des réflexions et des échanges de ce jour. Les organisateurs de la manifestation d’aujourd’hui – le président Combrexelle et la présidente de Saint Pulgent, dont je salue l’heureuse initiative et l’implication personnelle – ont choisi de partir des expériences « de terrain » et d’exemples concrets, selon une approche axée sur les politiques publiques et, par suite, de déborder la seule optique contentieuse que ne dédaigne pas le Conseil d’Etat, mais à laquelle son activité et sa vision ne sauraient se réduire.
Nous avons ainsi le plaisir d’accueillir des personnalités représentant l’ensemble des « parties prenantes » des accords en matière sociale, issues des organisations professionnelles, des administrations sociales, de l’Université, du Barreau et des juridictions suprêmes, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat.
Après avoir montré combien s’est développée en France la « méthode contractuelle » comme mode de régulation du social, non sans imperfections et difficultés (I), j’examinerai quelles sont les perspectives actuelles d’un redéploiement de cette méthode (II).
I. La méthode contractuelle, en se développant dans le champ du travail et de la santé, a complexifié, sinon brouillé, l’articulation entre les normes unilatérales et conventionnelles. Elle a aussi soulevé des problèmes de gestion et de gouvernance.
A. La régulation conventionnelle, qui avait longtemps été à la fois minorée et subordonnée, est montée en puissance et elle s’est en quelque sorte émancipée à compter des années 1980.
1. Elle est en effet une pratique ancienne de notre modèle social. Dans le domaine du travail, elle a été légitimée dans son principe et étendue dans son champ grâce à une interprétation dynamique des règles constitutionnelles, du 8ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, comme de l’article 34 de la Constitution en particulier. S’il revient au législateur de déterminer les conditions et garanties de mise en œuvre du principe de participation, il lui est en effet loisible « de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les modalités concrètes d’application des normes qu’il édicte. Le législateur peut par exemple « renvoyer au décret ou confier à la convention collective le soin de préciser les modalités d’application des règles fixées par lui pour l’exercice du droit de grève ».
Dernièrement, la loi dite « Macron » du 6 août 2015 a confié aux partenaires sociaux la mise en œuvre du nouveau dispositif en matière de travail dominical. Comme l’a relevé le président Dutheillet de Lamothe, « en mettant exactement sur le même plan le recours au décret et le recours à la négociation collective, [la jurisprudence du Conseil constitutionnel] consacre l’accord collectif comme une source constitutionnelle du droit du travail. Une fois adoptée, une convention collective voit, au même titre que les contrats légalement conclus, sa sécurité juridique constitutionnellement protégée : une loi ne saurait porter à un accord collectif antérieur une atteinte qui ne serait pas justifiée par un motif intérêt général suffisant.
Dans un autre domaine, celui de la santé, la méthode contractuelle est aussi un outil traditionnel, qui permet de réguler du secteur de la médecine ambulatoire : depuis 1971, des conventions nationales sont ainsi conclues par la Caisse nationale d’assurance maladie, puis l’Union nationale des caisses d’assurance-maladie (UNCAM) avec les représentants des professions de santé et, d’abord, des médecins.
2. Peu à peu, le champ de la régulation conventionnelle a été étendu. Toujours dans le domaine de la santé, le périmètre des conventions médicales a été élargi, tandis que la norme négociée joue désormais un rôle central dans la régulation globale de l’offre de soins. À cet égard, peuvent être mentionnés les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) conclus par les agences régionales de santé (ARS) avec les établissements de santé. Dans le domaine du travail, comme l’a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 avril 2004, le législateur peut « laisser les partenaires sociaux déterminer, dans le cadre qu’il a défini, l’articulation entre les différentes conventions ou accords collectifs qu’ils concluent au niveau interprofessionnel, des branches professionnelles et des accords d’entreprises ».
Ne revêt donc pas une valeur constitutionnelle le principe dit « de faveur », selon lequel « la loi ne peut permettre aux accords collectifs de travail de déroger aux lois et règlements ou aux conventions de portée plus large que dans un sens plus favorable aux salariés ». Ainsi, dans le cadre défini par la loi, une régulation conventionnelle dérogatoire s’est-elle développée, non seulement à l’égard des lois et règlements, depuis les lois dites « Auroux » de 1982, par exemple en matière de contingent d’heures supplémentaires, mais aussi à l’égard des accords collectifs supérieurs, sauf s’ils s’y opposent, depuis la loi dite « Fillon » de 2004 – cette dernière permettant à un accord d’entreprise de déroger à un accord de branche ou à un accord interprofessionnel, sauf si ce dernier en dispose autrement et à l’exception de certaines matières. Comme dans d’autres pays européens, s’est dès lors produite une décentralisation de la négociation collective, au plus près des réalités locales, qui peut déboucher sur une régulation de proximité.
3. Ce développement de la méthode contractuelle et, au-delà, de la norme négociée est, il faut le souligner, un facteur d’acceptabilité de la norme sociale et de responsabilité des acteurs sociaux. C’est aussi, par conséquent, un facteur de stabilité de cette norme. Le temps consacré à l’élaboration d’accords, même lorsqu’ils ne sont pas juridiquement contraignants (comme les accords sur la régulation des dépenses de santé) ou même lorsqu’ils imposent – pour être mis en œuvre – le vote d’une loi apparaît en effet comme un investissement utile qui favorise le développement d’une pédagogie, l’adhésion aux normes négociées et une meilleure appropriation de celles-ci par le corps social. De cette manière, s’est révélée particulièrement féconde la mise en œuvre de l’article L. 1 du code du travail qui subordonne l’élaboration de tout projet de réforme sur les relations individuelles et collectives du travail et relevant du champ de la négociation nationale interprofessionnelle à une concertation préalable avec les organisations syndicales en vue de l’ouverture éventuelle d’une négociation.
Cet article, né des controverses ayant entouré le lancement en 2006 du projet de « contrat première embauche » sans aucune concertation préalable, a permis, sans mettre en cause les compétences du Parlement, d’associer les partenaires sociaux et de faire progresser les consensus sur les réformes intervenant dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Toutes les réformes importantes menées à bien dans ces champs ont depuis lors été précédées d’une telle concertation et, le plus souvent, d’une négociation conclusive.
B. En dépit de ces avancées indiscutables, l’essor de la norme négociée présente, de l’avis unanime des experts, un bilan mitigé qui s’explique par plusieurs facteurs.
1. Si le bilan statistique de la négociation collective apparaît satisfaisant, le contenu des accords révèle une insuffisante appropriation des outils très sophistiqués mis à la disposition des partenaires sociaux et un manque d’intérêt, voire une certaine défiance à l’égard de l’efficacité de la régulation conventionnelle. La faculté de passer des accords d’entreprise dérogatoires n’a pas été pleinement utilisée, tandis que « les accords porteurs d’innovation sociale restent peu nombreux, généralement portés par quelques branches ou groupes d’entreprises ». Rares sont ceux qui « portent un regard tourné sur l’extérieur et, plus particulièrement, sur la précarité et les personnes au chômage ».
Cette situation, qui accentue une forme de « dualisation » du marché du travail, se reflète dans la moindre implication des dirigeants d’entreprise et de leurs directions des ressources humaines – les procédures de négociation collective étant perçues comme trop longues, complexes, coûteuses et juridiquement incertaines. Elle se manifeste aussi par un certain manque de confiance des responsables syndicaux – les temps de négociation étant parfois vécus comme une obligation formelle et peu attractive.
Par ailleurs, même si des progrès considérables ont été accomplis ces dernières années, la régulation conventionnelle s’est, dans le champ de la santé et de l’assurance maladie, mâtinée de beaucoup d’unilatéralisme. En dépit de la logique d’autonomie du système conventionnel, l’État s’immisce de plus en plus depuis un quart de siècle dans la régulation des dépenses de santé, pour en renforcer l’efficacité et aussi pour se conformer à nos engagements européens, résultant notamment du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union européenne.
En outre, malgré les avancées enregistrées, il est apparu que la régulation conventionnelle peine à assurer la pleine maîtrise des finances sociales – qu’il s’agisse du financement des dépenses de sécurité sociale, de l’assurance-chômage ou même des régimes obligatoires de retraite complémentaire des salariés du secteur privé. Ces derniers, gérés par les partenaires sociaux au travers de l’AGIR, se trouvent, selon les termes mêmes de la Cour des comptes, dans une situation financière « alarmante » : déficitaires depuis 2009, ces régimes couvrant plus de 18 millions de salariés et 12 millions de retraités, ne disposeraient plus des réserves nécessaires au versement des pensions, dès 2018 pour l’AGIRC et en 2023 pour l’ensemble AGIRC-ARRCO. C’est pourquoi, l’accord conclu le 30 octobre dernier par les partenaires sociaux revêt une importance cruciale.
2. Les facteurs expliquant ce bilan mitigé sont multiples. Outre les problèmes de gestion et de gouvernance, très prégnants dans le domaine de la santé, ces facteurs résident dans l’imperfection du cadre juridique actuel. Dans le domaine du travail, les marges de manœuvre laissées par la loi à la négociation collective ne sont pas clairement délimitées en raison de l’instabilité des dispositifs légaux et de leur stratification désordonnée. Ces marges apparaissent aussi trop étroites, la norme unilatérale étant excessivement imbriquée à la norme conventionnelle, dans des champs aussi essentiels que le temps de travail, les salaires, l’emploi ou les conditions de travail.
Par ailleurs, au sein de la hiérarchie conventionnelle, l’articulation entre les accords de branche et d’entreprise n’a pas été repensée, afin de permettre l’essor d’une régulation de proximité dans le respect des garanties communes propres à chaque secteur d’activité. La même exigence de complémentarité doit être recherchée à l’échelle individuelle : la protection des contrats de travail en cours d’exécution ne saurait entraver la défense des intérêts collectifs légitimes qui procède des accords négociés par les partenaires sociaux. À cet égard, comme l’a jugé le Conseil constitutionnel en 2012, l’adaptation du temps de travail des salariés à l’évolution des rythmes de production de leur entreprise peut être réalisée par voie d’accord collectif, sans même l’accord préalable de chaque salarié – cette adaptation revêtant un intérêt général suffisant.
À ces problèmes d’articulation normative, s’ajoutent des fragilités juridiques : la régulation conventionnelle s’est révélée, dans les champs spécifiques de la santé et du travail, particulièrement vulnérable. En amont comme en aval de la saisine du juge, il importe par conséquent de consolider l’accord collectif, alors que se décentralise la négociation sociale et que s’individualisent les relations du travail.
II. Pour atteindre cet objectif, la place de l’accord doit être clarifiée et son usage devrait être rendu plus simple et plus attractif.
A. En premier lieu, le redéploiement de la méthode contractuelle requiert une redéfinition de son objet et une sécurisation de ses outils.
1. Nous avons moins besoin d’une rupture ou d’un « big bang », que d’une refonte pragmatique de notre cadre juridique, dans la fidélité à nos valeurs et à la diversité de notre modèle social. Dans le domaine du travail, les bases d’une telle refonte ont été définies le 4 novembre dernier par le Premier ministre sous la forme d’une architecture tripartite. Au niveau de la loi, les principes fondamentaux du droit du travail constituent l’ « ordre public social », c’est-à-dire l’ensemble des règles auxquelles aucun accord collectif ne peut déroger, qu’elles soient strictement internes ou issues du droit de l’Union européenne. Dans le cadre ainsi défini, devrait se déployer à un deuxième niveau le champ de la négociation collective selon un principe de subsidiarité : aux accords de branche, la définition d’un « ordre public conventionnel », garantissant un socle pertinent de règles communes et prévenant ainsi tout risque de dumping social ; aux accords d’entreprise, la régulation de proximité, en fonction des caractéristiques propres à chaque structure locale. En troisième lieu, existeraient des dispositions supplétives, en principe de niveau réglementaire, pour les matières non couvertes par un accord collectif. Naturellement, la restructuration des branches professionnelles est un préalable nécessaire à cette refonte.
2. Une telle clarification peut permettre de libérer les initiatives, sans porter atteinte au socle des droits fondamentaux. Elle devrait consolider la place de l’accord collectif, dont les règles de validité ont été renforcées par les lois du 20 août 2008 et du 5 mars 2014 et qui bénéficie d’une présomption de légalité, selon cinq arrêts aussi récents qu’importants de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui reviennent sur la très critiquée jurisprudence « Pain » de 2009.
Pour autant, en réservant à la loi les principes fondamentaux, l’accord collectif ne s’émancipera pas du bloc de légalité et, le cas échéant, les juges judiciaire et administratif continueront d’y veiller. Comme le souligne Yves Struillou, ceux-ci auront à définir un « nouveau référentiel », « qui assure une conciliation entre l’impératif de légalité inhérent à tout État de droit et l’autonomie des parties à la négociation ». À cet égard, il ne saurait y avoir de confrontation brutale, voire de contradiction entre une norme négociée et un droit fondamental. À titre d’exemple, par un arrêt du 5 octobre 2015, le Conseil d’État a censuré un dispositif de différé d’indemnisation, prévu par une convention collective d’assurance-chômage et agréé par le ministre du travail, conduisant à priver certains salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse de leur droit à réparation.
B. Si une refonte du cadre juridique s’impose, elle doit s’accompagner en second lieu d’actions de mobilisation auprès des différents partenaires sociaux et de mesures tendant à renforcer la robustesse de la régulation conventionnelle. Comme le résume Jean-Denis Combrexelle, « L’une des difficultés principales réside dans la façon qu’ont les acteurs, pas seulement les syndicats, mais aussi les entreprises et leurs organisations, d’aborder la négociation collective, de la considérer comme utile, équitable et efficace, et de s’emparer des ressources que le droit leur offre ».
1. Plusieurs pistes ont été tracées pour renforcer l’attractivité des procédures de négociation. L’objectif est de garantir la loyauté de leur méthode, et les rendre plus accessibles et plus maniables, notamment grâce à des clauses de « revoyure » et des règles simplifiées de révision ou de dénonciation. En complément doit être garanti l’accès des salariés à une information compréhensible et complète sur les accords et conventions les concernant. C’est ainsi qu’une approche pragmatique et constructive du dialogue social pourra être pleinement promue. Car si, par notre droit et nos organisations, nous plaçons la négociation collective au cœur de notre tradition démocratique, nous n’en avons pas encore pleinement acquis la culture. D’une manière générale, la pratique de la négociation se heurte encore trop souvent à une « représentation belliciste de la vie sociale, pensée sur le mode de la confrontation militaire », peu favorable à un ajustement réciproque des exigences économiques et sociales. Une telle représentation ne peut qu’engendrer « une forte demande d’État en qualité de garant et de médiateur ».
L’État doit garder la maîtrise de ses compétences régaliennes et, notamment, sa faculté d’étendre des accords de branche, mais, hors de ce champ, il ne saurait se substituer aux corps intermédiaires pour pallier l’insuffisance du dialogue social – son rôle s’inscrivant davantage dans l’accompagnement, l’écoute et la pédagogie, ce qui représente déjà une tâche importante.
2. Un autre objectif s’impose à l’ensemble des parties prenantes. Il consiste à lutter efficacement contre l’insécurité juridique de la régulation conventionnelle. Il convient de l’encadrer par des règles aussi simples et stables que possible qui puissent être effectivement respectées. Il convient aussi de tenir compte de l’office particulier des partenaires conventionnels qui, sur la base du 8ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, sont investis par la loi de la défense des droits et intérêts des salariés et qui sont habilités à cette fin par la participation directe, c’est-à-dire le vote des salariés.
S’agissant du régime contentieux des accords collectifs, un équilibre doit être préservé entre, d’une part, l’exercice du droit au recours et la protection du principe de légalité et, d’autre part, l’objectif de stabilité des accords et de loyauté des relations conventionnelles. Cet équilibre doit régir non seulement les conditions dans lesquelles peuvent être contestés les accords collectifs et, dès lors, les conditions de saisine du juge, mais aussi les conditions dans lesquelles le juge exerce son contrôle de légalité et, par suite, la nature et l’étendue de son office. À cet égard, l’impact d’une irrégularité formelle ou procédurale sur la validité d’un accord doit être finement mesuré dans l’esprit de la jurisprudence « Danthony » de l’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat.
Il apparaît aussi nécessaire de s’assurer que les vices affectant un accord entraînent des conséquences graduées et proportionnées sur ses stipulations, son économie et, en dernier ressort, sa vie même – dans la ligne, par exemple, de la jurisprudence récente en matière de contrats de la commande publique. De même, dans les conditions fixées par le juge et notamment dans le délai qu’il a fixé, certaines irrégularités doivent pouvoir être régularisées par les autorités compétentes. C’est dans cet esprit qu’à défaut de régularisation et lorsque s’impose une refonte substantielle de l’acte annulé, a été forgée en 2004 à des fins de sécurité juridique une jurisprudence permettant de moduler dans le temps les effets d’une annulation contentieuse et d’éviter ainsi l’apparition d’un « vide juridique ».
En un mot, le juge doit rester pleinement maître de son office et conscient de ses responsabilités, en reconnaissant la spécificité de l’accord collectif et en conjurant tout risque d’instrumentalisation préjudiciable à l’intérêt général. Les récents arrêts du 27 janvier 2015 de la chambre sociale de la Cour de cassation vont précisément dans ce sens. Il n’est pas douteux que ces perspectives doivent aussi être transposées dans le champ de la régulation contractuelle en matière de santé et de protection sociale. Sur l’ensemble des points que je viens d’évoquer, le présent colloque permettra d’identifier des bonnes pratiques, d’échanger des expériences et des points de vue et d’envisager des perspectives d’avenir.
Le déroulement du colloque suivra naturellement le « cycle de vie » d’un accord : depuis sa conception et l’examen de ses finalités, jusqu’à son exécution, en passant par sa négociation et son entrée en vigueur et, le cas échéant, sa reprise par un texte législatif ou réglementaire. Je tiens à remercier pour leur présence et leur implication les présidents des quatre tables rondes ainsi que l’ensemble des intervenants qui ont accepté de partager avec nous leurs réflexions et leurs expériences. L’identité de notre modèle social s’est forgée autour du principe de participation et par un large recours à la norme négociée. Les transformations contemporaines de notre démocratie et, en particulier, des relations entre les administrations et le public, montrent la pertinence et la modernité de ce modèle, auquel nous pouvons moins que jamais renoncer et au service duquel nous devons mobiliser nos facultés collectives d’adaptation et d’innovation. »