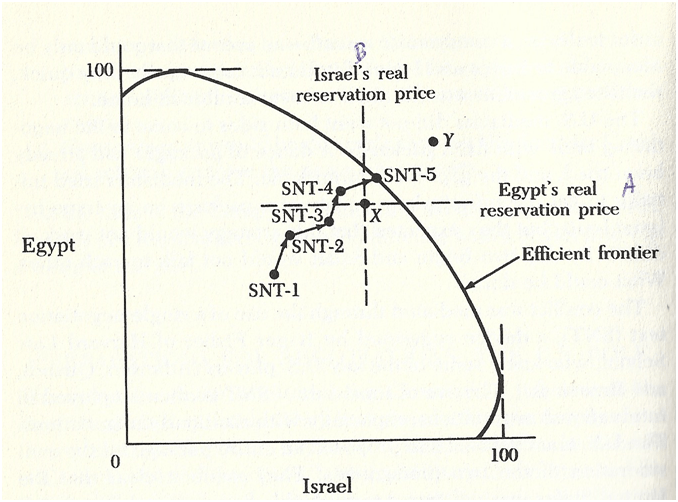Roboratif et analeptique. Ces deux qualificatifs traduisent le fait de redonner des forces. La tribune publiée hier dans le journal Le Monde et signée d’Astrid Panosyan-Bouvet, ancienne ministre du travail dans le gouvernement de François Bayrou (lire ici) est roborative et analeptique. Pourquoi la qualifier ainsi ?
Parce qu’écrite par celle qui fut conseillère d’Emmanuel Macron puis députée Renaissance et ministre de décembre 2024 à octobre 2025, cette tribune donne du poids à différents arguments, encore peu audibles dans l’arène publique et politique mais appelés à être ardemment discutés ces prochains mois. Et venant de la part de celle qui était, il y a encore un mois ministre du travail, c’est revigorant… Parmi ces arguments, qui devraient matricer nos débats publics ces prochains mois, relevons ceux-ci :
L’argument de la lucidité. Astrid Panosyan-Bouvet a raison de citer Le Livre blanc sur les retraites de Michel Rocard, alors Premier ministre, en 1991, et nous inviter à « préparer les base d’un débat plus serein en montrant que la démographie nous oblige à travailler plus longtemps mais qu’il faudra également travailleur mieux ». Relire aujourd’hui la préface de Rocard à son Livre blanc (lire ici) est également analeptique. Je cite ici deux de ses phrases puis discute l’un de ses arguments majeurs : « Nous avons vis-à-vis des générations futures un devoir de lucidité et un impératif de solidarité » (p. 9) et « Une démocratie comme la nôtre doit être capable de débattre à temps de ces problèmes et d’en traiter sereinement » (p. 10). 35 ans plus tard, la feuille de route reste la même. Qui osera le contester ?
Parmi les données chiffrées que présentaient Michel Rocard, retenons celles-ci, et qui font écho à celles que produit Astrid Panosyan-Bouvet : en 2010, se projetait-il alors, avec un hausse annuelle d’ici cette date du taux d’emploi de 0,5 % et une progression annuelle de 2 % du pouvoir d’achat des actifs, le besoin de financement pour tous les régimes de retraite serait, annonçait-il, de l’ordre de 300 milliards de francs (soit 75 milliards d’euros de 2025). Cela reviendrait, poursuivait Rocard, à faire passer le taux de cotisation sur les salaires de 18,9 % (en 1991) à 25 % (en 2010). En 2035, ajoutait-il, ce taux atteindrait 35 %. Il en concluait : « Ce scénario est inacceptable ». Dans sa tribune, Astrid Panosyan-Bouvet nous rappelle que le taux 2025 des cotisations salariales est aujourd’hui de… 28 % ! « L’inacceptable » de 1991 est devenu une réalité. Que faire ?
L’argument du compromis. Ne plus se focaliser sur le seul âge légal de départ à la retraite (et ne plus promettre – faussement – de revenir à 62 ou 60 ans, ce que la réforme – socialiste – de 2014 ne promettait d’ailleurs pas…) mais envisager des départs « à la carte », selon le libre choix de chacun, avec le nombre nécessaire de trimestres de cotisations mais assorti de bonus, pour tenir compte de la pénibilité du métier et de l’âge d’entrée en emploi. Car le problème, et Astrid Panosyan-Bouvet a raison d’insister sur ce point, n’est pas l’âge légal lui-même (64 ans, qu’on ne pourra d’ailleurs, à terme, que prolonger) mais le départ précoce des seniors de leur emploi et l’insertion tardive en emploi des jeunes.
Ce qu’elle ne dit pas – on imagine qu’elle ne peut se risquer à le dire tout haut… – c’est que cette réforme des retraites, à partir de 2022, a fortiori en 2023 et le passage en force du gouvernement, a été fort mal vécue par les salariés, moins sur le fond que sur la forme, avec cet autisme du président de la République élevé au rang d’un de nos beaux-arts. Qu’Olivier Dussopt – que j’ai connu au début des années 2000, lorsqu’il était secrétaire de la section du PS d’Annonay, avant qu’il n’en devienne le maire puis le député local en 2007, et dont m’horripilaient alors ses discours critiques de la social-démocratie (il avait soutenu en 2008 la motion commune de Benoit Hamon et Jean-Luc Mélenchon au Congrès de Reims…) – qu’Olivier Dussopt, donc, deux ans après le non-vote au Parlement de la réforme de l’âge légal de départ en retraite, critique publiquement la suspension jusqu’en 2027 de cette réforme, en dit long sur l’état de déconnexion du réel de certaines élites politiques. Le communiqué de cet ancien ministre du travail, aujourd’hui senior advisor du fonds de capital-risque Daphni Partners, est, à cet égard, un cas d’école (lire ici) : « Remettre en cause la seule et dernière réforme structurelle du second quinquennat d’Emmanuel Macron est une grosse erreur. Cela va ébranler la confiance des marchés et celle-ci est importante pour que l’État puisse se financer. Un compromis politique ne peut pas se construire sur un déni comptable et sur le dos des générations qui viennent. »
Paris vaut bien une messe, dit-on, prêtant ce trait à Henri IV (ou à son conseiller, Maximilien de Béthune, plus connu sous le nom de Sully) et qui, par là, justifiait sa seconde conversion au catholicisme, lui, l’ancien chef de guerre huguenot, bataillant contre cette armée royale dont il devint ensuite le commandant en chef. Voter le budget 2026 vaut bien une suspension jusqu’en 2027 d’une réforme honnie car mal pensée, mal discutée, mal expliquée et mal votée, pourrait-on objecter à cet ancien ministre du travail. Par définition, un compromis politique coûte à celles et ceux qui, pour atteindre leurs objectifs, acceptent de se désister d’une part de leurs prétentions. Que serait un compromis où les parties ne modifient aucune de leurs préférences ? Un ensemble vide, Ø. Qu’est-ce un compromis politique entre des partis représentés au gouvernement et d’autres partis, opposants mais aspirant à gouverner à leur tour ? Une mise en compatibilité de certaines de leurs options programmatiques, où les désistements des uns sont conditionnés aux désistements des autres, et où chacun accepte de surseoir provisoirement à la satisfaction de ses exigences si le nouvel état du monde créé par la coopération des parties est jugé supérieur en gains à l’ancien état du monde, fondé sur leur compétition. Le problème n’est donc pas la « confiance des marchés » ou le « déni comptable » mais la manière dont on pose un problème public, dont on en débat publiquement, dont on en construit, pas à pas, la solution. Là réside l’essentiel, et il nous est rappelé par celle qui fut, elle aussi, ministre du travail jusqu’en octobre 2025…
L’argument de l’activité. Il est primordial : les seniors quittent précocement l’emploi ; les jeunes y entrent tardivement. En 1970, il y a avait 3 cotisants pour un retraité ; en 2004 : 2,2 cotisants ; en 2024 : 1,7 cotisants. Il faut donc ramener à l’emploi celles et ceux qui en sont privés trop tôt, et amener à l’emploi celles et ceux qui y arrivent trop tard. Il n’existe pas de recettes miracles mais un mixte de mesures concrètes, qui devront être portées conjointement par les partenaires sociaux et les services concernés de l’État – ministères de l’éducation, de la santé, du travail, etc. Ce sont là de quasi-causes nationales. Défendons-les.
L’argument de la productivité. Bien posé, il parle à tous : si pour produire 100 et que nous sommes 63 à y contribuer (le taux d’emploi en Italie), porter ce chiffre d’emplois à 82 (le taux d’emploi des Pays-Bas) devrait, en toute logique, permettre au pays concerné de produire 130. D’autres facteurs entrent en jeu : la capacité d’innovation des entreprises (si leurs produits sont moins chers et plus performants, leurs ventes vont progresser, et leurs marges augmenter ; elles embaucheront et paieront plus d’impôts au Trésor public ; qui pourra investir dans les programmes de formation à l’innovation dans les lycées et les universités…) ; la numérisation de leurs activités (si la saisie informatique des données de production prend 10 minutes par jour au lieu des 30 minutes d’hier, les deux heures ainsi gagnés par semaine peuvent être utilement redéployées dans des activités productives de valeur…) ; la hausse des compétences de la main-d’œuvre salariée (si les équipes de travail savent désormais faire aussi bien (voire mieux) que les équipes de la concurrence, l’entreprise voit arriver de nouveaux clients, heureux de disposer de champions au coin de leur rue…), etc. Le cercle est vertueux. Pourquoi n’y a-t-il pas de débats de société autour de ces sujets ? La productivité du travail n’est pas un gros mot – ni un concept pour hurluberlus. En 2007, la France occupait le 8ème rang mondial du classement des PIB par heure travaillée, puis le 11ème en 2017 et le 12ème en 2004. La faute n’est pas celle des salariés qui, chaque jour, font ce qu’ils ont à faire, et tentent de le faire bien. La faute est celle d’une société qui ne sait plus avancer car elle a désappris à délibérer, expérimenter et recommencer encore…
L’argument de la reconnaissance. Pourquoi le fait de porter l’âge légal de départ en retraite à 64 ans a-t-il mis pendant plusieurs samedis du printemps 2023 des centaines de milliers de salariés dans la rue ? Parce que grand était leur ressentiment. Parce que 66 % des employés de service, dans une enquête de la DARES de 2019, 55 % des infirmiers ou 50 % des ouvriers qualifiés du bâtiment ne se sentaient « pas capables de faire le même travail jusqu’à leur retraite » (lire ici).
Rappelons ici ce constat de la DARES (Dares-Analyses, n° 17, mars 2023) : « Les métiers les moins qualifiés, au contact du public ou dans le secteur du soin et de l’action sociale, sont considérés par les salariés comme les moins soutenables. Les salariés jugeant leur travail insoutenable ont des carrières plus hachées que les autres et partent à la retraite plus tôt, avec des interruptions, notamment pour des raisons de santé, qui s’amplifient en fin de carrière. Une organisation du travail qui favorise l’autonomie, la participation des salariés et limite l’intensité du travail tend à rendre celui-ci plus soutenable. »
Parce que la verticalité des pratiques managériales – ce qu’a confirmé un récent rapport de l’IGAS, l’inspection des affaires sociales, publié en juin 2025 (lire ici) – accentue le ressentiment des salariés, qui se jugent mal reconnus : « Les pratiques managériales françaises apparaissent très verticales et hiérarchiques. De même la reconnaissance du travail, item déterminant de la qualité du management, est-elle beaucoup plus faible que dans les autres pays de la comparaison, et la formation des managers très académique et peu tournée vers la coopération, malgré des progrès que le développement de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur devrait amplifier. » (p. 3)
L’argument du libre choix. On ne travaille pas à 60 ans comme à 30 ans ; un universitaire ne travaille pas comme un manutentionnaire ; un acteur, comme un facteur. La nécessité de travailler plus longtemps, souligne Astrid Panosyan-Bouvet, « ne peut s’imposer de la même manière à tous ». On lui objectera que ces propos auraient été bienvenus en 2022 et 2023 quand la réforme générale du système de retraite, envisagée dans un premier un temps, s’était noyée dans une réforme paramétrique où le changement ne concernait plus que l’âge légal, uniformisé pour tous. On ajoutera, pour sa défense, qu’il n’est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs et encore moins pour affirmer haut et fort, dans une tribune du journal Le Monde, que ce qui avait été esquissé en 2019, puis abandonné l’année suivante pour cause de Covid-19, puis mis de côté en 2022 par les gouvernants de l’époque, doit être désormais mis sur la table, discuté, amendé, imaginé, etc. S’il y a suspension de la réforme de 2023 jusqu’au 1er janvier 2028, il n’y a pas suspension du déficit structurel des comptes sociaux ni suspension de l’ardente nécessité d’en débattre sereinement et collectivement…
L’argument de l’écoute du travail. Pour qu’une réforme soit adaptée, écrit Astrid Panosyan-Bouvet, « il faut cesser de prendre le problème à l’envers ». Cela fait 15 ans, souligne-t-elle, qu’on ne cesse de réformer nos retraites sans jamais parler du travail – ou si peu, ou si mal. Nous devons placer le travail au cœur des politiques sociales et de nos débats publics. L’éditorial du dernier numéro de la revue Cadres de la CFDT Cadres dit à ce sujet l’essentiel (lire ici). Suggérant d’adopter « une approche sensible, politique et réflexive de l’activité humaine dans les organisations », Laurent Tertrais, son rédacteur en chef, écrit ceci : « Cette stratégie de l’écoute passe notamment par le développement d’un dialogue professionnel, ancré dans les réalités quotidiennes, pour combler les lacunes inévitables des règles, en donnant aux travailleurs et aux équipes les moyens d’ajuster ou de les compléter face aux imprévus, en donnant aux managers des marges de manœuvre, en reconnaissant leur rôle de créer des régulations. »
L’argument du dialogue social. On ne peut demander, affirme Astrid Panosyan-Bouvet, « au seul système de traiter et de corriger a posteriori les inégalités du monde du travail, mais il doit réparer les inégalités les plus fragrantes : pénibilité, carrières longues, maternité, minimum vieillesse. Pour le reste, c’est ici et maintenant qu’il faut agir, à travers un dialogue social dynamique et un État qui prend ses responsabilités quand ce dialogue est bloqué. » Ici et maintenant, hic et nunc ? Oui. Ne reportons pas à 2027, ou à 2032, ou à de prochaines législatives, ou à un Grand soir quelconque, la prise en compte des différents facteurs conduisant les salariés français, à la différence de leurs homologues européens, à se projeter dans une retraite future pensée comme un « paradis différé » (l’expression est celle de l’ancienne ministre du travail, et elle fait mouche). Et nuls autres qu’employeurs et syndicalistes, aux différents niveaux de notre système de relations collectives de travail (interprofessionnel, professionnel, territorial et d’entreprise), accompagnés par des experts, des consultants et des agents des DDETS, tous travaillant en réseau, ne pourront faire ce nécessaire travail de prise en compte des multiples maux du travail et d’y apporter des réponses précises, concrètes et équitables.