(Je reproduis ci-dessous quelques extraits d’un rapport du think tank Terra Nova, de février 2019, rédigé par Danièle Kaisergruber, Gilles-Laurent Rayssac et Martin Richer, intitulé Délibérer en politique, participer au travail : répondre à la crise démocratique.
Je souhaite ici – d’autres billets de blog poursuivront ce travail – contribuer à notre réflexion collective sur le dialogue social en explorant des angles inédits, des thématiques émergentes ou des dispositifs novateurs, de sorte que nos approches en soient renouvelées et que nous puissions, collectivement, « faire bouger les lignes »… Je commence cette série de billets par une thématique qui m’est chère : la délibération dans l’entreprise. Rien de mieux, pour explorer cette question de la délibération collective dans l’entreprise contemporaine, que commencer par ce rapport de Terra Nova, rédigé par de solides spécialistes du débat public et des relations de travail, et dont la présentation sur le site de Terra Nova se termine par ses mots : « Ce qui est frappant dans la vie politique l’est aussi dans l’entreprise : les décisions sont souvent prises sans que les personnes concernées se sentent véritablement impliquées. C’est ce parallèle entre les intermittences de la démocratie dans l’espace public et le manque de dialogue dans les entreprises et les organisations que Terra Nova a voulu explorer dans ce rapport. »)
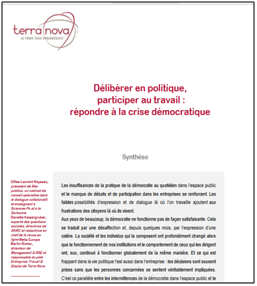
Démocratie dans l’entreprise et dans la société sont liées
Dans son rapport, publié en 1982, Jean Auroux livrait la logique à l’origine des textes de loi qui portent son nom : « Citoyens dans la cité, les travailleurs doivent l’être aussi dans l’entreprise ». Le travailleur et le citoyen sont indissociablement liés. (…) L’éloignement entre les citoyens et les politiques, les premiers considérant que les seconds ne les écoutent pas, ne les comprennent pas et ne vivent pas comme eux (voir l’enquête annuelle du Cevipof sur la confiance ; lire ici) trouve sa correspondance dans l’entreprise dans laquelle, année après année, s’est creusé un fossé jusqu’à former ce qu’Altedia a qualifié de « crise de confiance dans la relation employeurs-salariés » (…)
La parole publique prend des formes multiples dans notre société : états généraux, « Grenelles », concertations publiques avec ou sans garant, débats publics, consultations en ligne, forums citoyens, enquêtes d’utilité publique, démocratie participative. Comment croire que l’entreprise pourrait rester à l’écart de cette formidable poussée de la parole publique ? (…)
Analysant les dispositifs de démocratie participative (lire l’entretien ici), Loïc Blondiaux pointe l’impact de deux phénomènes : la montée en puissance des acteurs économiques transnationaux ou des GAFA, les géants du numérique et de l’Internet, dont l’impact sur les débats publics, les opinions et les modes de vie est considérable ; l’élévation du niveau d’éducation de la population et la diversification des sources d’information, qui ont accru les capacités de critique envers les gouvernants. « Les institutions et les gouvernements des démocraties représentatives sont donc doublement remis en cause, par le haut, avec l’affirmation d’acteurs économiques qui outrepassent les règles démocratiques et à qui les gouvernements ne peuvent imposer leur volonté, et par le bas, avec des citoyens qui n’acceptent plus de déléguer leur pouvoir et leur parole sans avoir la possibilité de s’exprimer. »
Le même phénomène est à l’œuvre dans l’entreprise, avec par le haut des salariés qui se jouent des règles de préséance, court-circuitent la hiérarchie et menacent le monopole de l’information et de la permission détenu par les managers et par le bas avec des collaborateurs bien formés, demandeurs d’autonomie et de liberté d’expression.
Le désenchantement du « management participatif »
Le management, tout comme l’organisation des entreprises (les grandes en particulier), suit des cycles : on décentralise, puis on recentralise ; on joue la participation des salariés, puis on rigidifie par des process contraignants et des reporting accablants… Les années 1980, et dans une moindre mesure la décennie suivante, ont été marquées par un cycle particulier : celui du management participatif. Tout comme la participation et la concertation publique, les entreprises et les consultants qui les accompagnent ont leurs mythes fondateurs et leurs exemples fétiches : dans ces années-là, on allait encore chercher ses modèles du côté de la « démocratie industrielle » suédoise (les équipes semi-autonomes de Volvo à Göteborg), voire du côté des conseils ouvriers italiens (les usines Fiat à Turin). Le fond de l’air avait encore un peu du parfum très « 1968 » de l’autogestion. Dans ces références, on était plutôt en milieu industriel, et les organisations du travail pouvaient/devaient refléter des rapports de force en faveur des ouvriers, leur donnant une autonomie et un poids qui devaient desserrer les contraintes économiques du capitalisme et surtout ouvrir vers un travail « post-taylorien ». Les syndicats et plus largement la politique y jouaient un rôle de premier plan même lorsqu’on admettait des espaces de démocratie à côté des syndicats. On imaginait que la mise en pratique de l’autogestion (Lip par exemple, sous forme coopérative) pouvait conduire à une remise en question des formes de propriété du capital. (…)
La France est l’un des pays où la « crise du travail » est la plus sensible. Elle est massivement ressentie par de très nombreux salariés des entreprises privées et agents des services publics. Voilà qui appuie notre hypothèse : l’absence de possibilité d’expression, de débats et de dialogue là où l’on travaille ajoute aux frustrations des citoyens, là où ils vivent.
La France, mauvaise élève pour la participation des salariés dans leur entreprise
Entre le dirigeant ou manager tyrannique qui ne demande son avis à personne et le manipulateur qui organise une pseudo-consultation sur des décisions déjà prises, existe-t-il un espace en entreprise pour un management réellement participatif ? Fort heureusement, oui ! Le terme espace devrait d’ailleurs être mis au pluriel car ces espaces d’autonomie, de prise de parole, d’initiative, de concertation ou négociation adoptent des formes multiples, parfois très institutionnelles et codifiées (le dialogue social classique par exemple), parfois beaucoup plus informelles (la fameuse et parfois insaisissable intelligence collective).
La singularité de la France se situe toutefois dans la résistance que ses entreprises et organisations opposent à l’éclosion et au développement de ces espaces. Elle reste un pays fortement marqué par les organisations du travail tayloriennes, qui ont repris du poil de la bête à la faveur des progiciels de gestion et du développement de la logistique. Également un pays où le goût des petites et grandes distinctions (de la taille du bureau à la marque de la voiture de fonction) révèle de fortes distances hiérarchiques.
(…) Ce n’est donc pas un hasard si c’est dans les pays du Nord que prospèrent les organisations du travail les plus efficaces, qui font appel à l’initiative et à l’autonomie des salariés. À l’inverse, ce retard de la confiance en France y rend la transition managériale d’un modèle basé sur la hiérarchie vers un modèle basé sur l’adhésion et la participation plus douloureuse (lire l’article de blog sur cette transition ici).
Ce retard se matérialise par un paradoxe. En France, la promotion de la modernité est partout, dans les livres, les colloques et les injonctions des dirigeants, qui promettent un management plus respectueux des individualités, de la créativité, de la capacité d’initiative, de l’implication des collaborateurs. Pourtant, au vu des études internationales, toutes les innovations managériales qui vont dans ce sens y sont très en retard (lire ici l’article de blog sur ces innovations).
Tous ces éléments font système au sein de l’entreprise et engendrent des frustrations, des replis et une attitude critique vis-à-vis des élites et des dirigeants.
Un dialogue social trop souvent formel
(…) S’agissant du dialogue social classique, on constate que la France est très en retard en matière de « dialogue social extensif » défini, selon la classification issue des études d’Eurofound, par le fait que les représentants du personnel disposent à la fois d’un bon niveau de ressources et d’un bon niveau d’informations. Les seuls pays qui figurent derrière nous sont Malte, le Portugal et la Roumanie… Ce qui signifie que souvent le dialogue social place les représentants des salariés dans une position d’observation, de consultation, ce qui permet la critique mais pas la participation aux décisions. La situation française se dégrade encore lorsque l’on arrive aux « choses sérieuses » : le partage des informations dites stratégiques, c’est-à-dire celles qui concernent les enjeux business, les nouveaux produits ou services, les changements dans les process ou les structures, les plans stratégiques. Ici, la proportion des établissements dans lesquels la direction partage ces informations avec les représentants du personnel tombe à 61 % pour la moyenne des 28 pays de l’UE et… à 47 % seulement pour la France.
Il faut réformer le dialogue social pour en faire un outil de progrès social et économique moins formel et plus orienté vers la négociation (lire ici l’article de blog plaidant pour cette réforme).
Les récentes réformes des règles du jeu qui simplifient le « millefeuille social » dans les entreprises constituent un socle pour un dialogue plus vivant, plus en prise avec les souhaits des salariés. Les négociations collectives en entreprise ont souvent été conduites de façon trop cloisonnée du fait des dispositions rigides du Code du travail mais surtout d’un jeu d’acteurs codifié. Les thématiques étaient découpées en fines tranches, correspondant aux domaines de négociation obligatoire. Par ailleurs, les instances de concertation étaient séparées avec les questions de santé au travail traitées d’un côté au CHSCT et les questions d’organisation ou les projets de transformation traitées au comité d’entreprise, de l’autre. La loi Rebsamen d’août 2015 a mis fin au premier cloisonnement et les ordonnances Travail de 2017 au second. Elles ont changé la donne en instaurant des domaines de négociation beaucoup plus larges et des instances de représentation du personnel unifiées. Les conditions légales pour un dialogue social davantage porteur de progrès sont désormais réunies. Mais il reste un profond changement culturel à opérer, pour passer d’un dialogue de confrontation à un modèle de négociation et co-construction.
La mise en œuvre de ces nouvelles règles pose cependant des défis aux entreprises : comment faire du lien entre les sujets de négociation ? Comment répartir des représentants – moins nombreux – tout en conservant des relations de proximité avec les salariés ? Comment conserver les compétences santé, sécurité au travail ? Suivre des formations communes pour la direction et les IRP sur la mise en place des nouvelles instances, faire vivre des espaces de discussion sur le travail en lien avec les espaces de dialogue social et avec le management, mener des projets de changements associant les salariés et leurs représentants sont quelques pratiques qui contribuent à enrichir les négociations.
Les hésitations du « dialogue professionnel » sur le travail
L’expression directe des salariés au travail est une voie de progrès mise en avant par l’accord interprofessionnel sur la qualité de vie au travail signé en juin 2013. Cet accord tente d’ouvrir la voie pour retrouver l’expression directe des salariés, organisée par l’une des lois Auroux de 1982 mais restée pour l’essentiel sans suite. Plusieurs raisons sont avancées, notamment par l’Anact, pour expliquer les limites de ce droit d’expression et le fait que salariés et syndicats se soient progressivement désengagés de ces espaces de parole : le cantonnement aux questions de conditions de travail et non les interrogations sur le travail en lui-même, la difficulté à dépasser les plaintes et critiques, des formes et styles d’animation inappropriés, le manque de précision et d’ambition sur l’usage de cette expression, la mise en concurrence avec d’autres modalités participatives alors déployées dans les entreprises (les cercles de qualité par exemple). On peut y ajouter le peu d’empressement des organisations syndicales, qui ont sans doute eu l’impression d’être « contournées » alors qu’elles avaient investi les instances de représentation (comités d’entreprise, CHSCT et délégués du personnel).
L’accord Qualité de vie au travail tire la leçon de cet échec. Les syndicats reconnaissent la nécessité de ménager des voies d’expression pour les salariés et de mise en discussion des questions de travail. Certaines directions d’entreprise comprennent l’intérêt de cette approche en matière de prévention des risques psychosociaux, d’amélioration des conditions de travail, de cohésion sociale et d’innovation.
Il s’agit de donner aux salariés la possibilité de faire mûrir ensemble la question du travail : ce qu’il faut améliorer, ce qui ne va pas, ou au contraire les sources de satisfaction ; bref, mettre le travail en débat. C’est ici que réside la question essentielle d’une « démocratie du quotidien », celle qui dépasse les processus électifs pour permettre à chacun d’être pleinement acteur et à la délibération collective de produire ses fruits. D’après l’Anact, qui est l’un des promoteurs de la démarche, « les espaces de discussion sont ainsi des espaces collectifs qui permettent une discussion centrée sur l’expérience de travail et ses enjeux, les règles de métier, le sens de l’activité, les ressources, les contraintes. Cette discussion, dont le vecteur principal est la parole, se déroule suivant un cadre et des règles co-construites avec les parties prenantes. Ce sont des espaces inscrits dans l’organisation du travail. Ils s’articulent avec les processus de management et les Instances représentatives du personnel, et visent à produire des propositions d’amélioration ou des décisions concrètes sur la façon de travailler. Ils sont un moyen au service des individus (reconnaissance, développement, engagement), des organisations (performance collective, dialogue social, processus décisionnel partagé) et du travail (transformation concertée de l’activité et développement des pratiques du métier) » (lire ici l’article Mettre en place des espaces de discussion de l’Anact).
La mise en place d’espaces de discussion est plébiscitée à un niveau très élevé : elle est perçue comme une bonne chose par 94 % des salariés, et plus encore dans les plus grandes entreprises ! Malgré cet atout, l’existence de tels espaces de discussion est encore confidentielle : seuls 23 % des salariés déclarent en bénéficier aujourd’hui, dont 15 % qui y ont effectivement participé (enquête Harris de 2015 ; lire ici).
(…) Au fond, la question posée est : permet-on au salarié d’avoir la satisfaction (et la fierté) de bien faire son travail ? Un travail satisfaisant, c’est un travail dans lequel le salarié peut être en accord avec ses valeurs personnelles, son éthique professionnelle et être satisfait de la qualité produite. En fait la question est double : il y a aussi celle du pouvoir de l’employeur que le Code du travail et les représentations continuent de voir comme l’« ordonnateur du travail » dans le cadre d’un lien de subordination et non de coopération. C’est aussi une activité qui matérialise la contribution du salarié, sa touche personnelle, son apport au collectif de travail, à l’entreprise, au monde. C’est la meilleure façon de se prémunir des risques psychosociaux. D’où l’importance de la notion d’« entreprise contributive », sur laquelle Terra Nova s’est engagée, c’est-à-dire une organisation qui crée les conditions de cette réalisation de soi par son travail (lire ici le rapport L’Entreprise contributive : 21 propositions pour une gouvernance responsable).
Le dialogue professionnel est un exercice de démocratisation du travail, qui structure des procédures de prise en compte des aspirations de chacun, d’échanges contradictoires, de règlement pacifié des désaccords et de construction d’un avenir commun. Pour cela, l’Anact donne quelques conseils concrets : « La parole ne se décrète pas ! Elle exige un cadre et des règles : liberté de s’exprimer, confiance, non-jugement. […] La participation est basée sur le volontariat et le souhait d’améliorer la qualité de vie de l’entreprise. Pour cela, les participants doivent respecter les individus et les engagements ; s’interdire de recourir à un procès d’intention, les informations données devant être objectives et fondées sur des éléments factuels en lien avec des situations de travail concrètes ; garantir une confidentialité des propos des personnes présentes ; et au final se responsabiliser dans leur prise de parole. » Cela pourrait constituer la charte de bien des démarches de délibération menées par l’État, par les collectivités comme par les entreprises. (…)
Prochain billet : L’entretien avec l’un des co-auteurs du rapport Terra Nova, Martin Richer.





